Il y a quelques semaines, tout Twitter (…ou en tous cas toute ma timeline) parlait de cet épisode de Grey’s Anatomy. Je ne regarde pas Grey’s Anatomy ; j’en ai vu plusieurs épisodes, au tout début, en grande partie parce que je vivais avec quelqu’un qui les regardait assidument. Cela fait bien longtemps que je ne ressens plus l’envie de regarder la série par moi-même, et je ne vis plus avec quelqu’un qui m’y incite. Du coup, bah, j’ai arrêté, logique. Il y a cependant quelque chose de fascinant, pour la téléphage que je suis, dans l’idée abstraite qu’un medical drama ayant duré 15 ans réussisse encore à susciter des discussions de par les sujets qu’il aborde, non seulement pour ses personnages mais surtout pour ses intrigues médicales. Quelque chose d’émouvant, même.
Si ces intrigues médicales font tant parler d’elles, ce n’est pas pour leur exactitude technique. Non, c’est avant tout parce que Grey’s Anatomy est capable de discuter de cas médicaux sous un angle qui émeut. Ce n’est pas sale : le génie de Grey’s Anatomy, l’essence-même de sa popularité, c’est que la série est capable d’utiliser l’émotion pour s’inscrire dans des discussions sur des sujets de société. Quand la série parle de violences sexuelles, rien n’est foncièrement nouveau dans les connaissances médicales en jeu, en fin de compte. Le discours, lui, a plus de chances de l’être.
Sans mauvais jeu de mot, dans une série médicale, c’est le traitement qui fait tout… Or, le traitement des cas médicaux dans une série est le reflet de notre époque. Cette semaine j’ai regardé le premier épisode de Dr. Kildare, une série médicale remontant à 1961 ; et je suis revenue à cette réflexion. Je me suis aussi dit que, bon sang, on en a fait du chemin.

James « Jim » Kildare est un jeune interne, qui vient de rejoindre une aile du Blair General Hospital appelée Ward E, et dédiée à la médecine interne. Il est désireux d’apprendre dans les meilleures conditions afin de devenir médecin, et c’est d’ailleurs la raison-même de sa présence dans la Ward E, qui est supervisée par le docteur Leonard Gillespie, qu’il admire. Kildare espère faire son internat sous l’autorité de Gillespie et obtenir sa résidence grâce à lui. Évidemment ce n’est pas si facile : les places sont chères, et le Dr Gillespie a en plus une réputation de professionnel exigeant et intraitable.
Au sein du service, Kildare doit donc faire ses preuves, tout en accomplissant les tâches les moins excitantes. Toutes nécessaires qu’elles soient, elles ne représentent pas ce que Kildare veut faire, ni la médecine qu’il veut incarner. A lui les gardes interminables (le premier épisode s’intitule d’ailleurs « Twenty-four hours« ), les prises de sang, les examens d’admission… et côtoyer les patients juste d’un peu plus près qu’il ne le voudrait.
Bien que la série porte le nom de Dr Kildare, ce titre et cette fonction sont donc complètement relatifs. Par-dessus le marché, la série ne veut pas vraiment nous parler d’un médecin, mais plutôt de la façon dont cet interne va apprendre ce que signifie la médecine (j’ai aussi eu de grosses pensées pour Scrubs pendant cet épisode, d’ailleurs). Comme beaucoup de jeunes médecins qui lui ont succédé sur les écrans de télévision, Kildare a tendance à vouloir brûler les étapes, à nourrir des ambitions dépassant ses attributions actuelles, et à s’imaginer plus capable qu’il ne l’est. Mais Dr Kildare pousse vraiment les choses à l’extrême en dépeignant son héros éponyme de façon parfois franchement antipathique ; il est ostensiblement outré en permanence qu’on ne l’estime pas plus. Quand il se plaint, ce n’est ni écrit ni réalisé ni joué pour nous faire compatir. On n’est pas vraiment supposé s’identifier à lui, se sentir touché par ses difficultés, ou partager ses hauts et ses bas, mais plutôt l’observer alors qu’il est sur le point d’évoluer, un peu malgré lui d’ailleurs.
Le premier cas rencontré dans ce contexte par le docteur Kildare est celui de Julia Dressard, une femme amenée dans la Ward E dans un état d’ébriété avancé. C’est une patiente difficile, qui refuse de se laisser soigner, et Kildare ne masque pas son mépris de la patiente… ce qui n’aide pas franchement. En un sens, il voudrait la soigner malgré elle, mais n’a pas vraiment envie non plus de s’en charger parce qu’il la trouve antipathique. Il faut dire qu’en tant qu’alcoolique, Julia Dressard est traitée comme une hystérique et une menteuse aussi bien par la série que par Kildare ; progressivement, Julia comme le docteur Kildare vont devoir s’ouvrir un peu à la possibilité que l’autre est digne de confiance.
Si quelques autres cas sont très rapidement abordés dans ce premier épisode (pendant la tournée dirigée par Gillespie), seul le cas Dressard a vraiment de l’importance ici. Il est là pour administrer à Kildare une leçon d’importance, la première d’une longue liste : apprendre l’humilité. C’est le premier pas pour admettre l’humanité des patients, et commencer à réellement les soigner.
Le moment pivot de l’épisode réside dans l’une des rares scènes opposant Kildare à Gillespie. Après avoir échoué de façon répétée avec Julia Dressard, Kildare se retrouve dans le bureau de son supérieur, se faisant remonter les bretelles comme jamais. Et c’est puissant.
C’est puissant non pas parce que Gillespie apprend quelque chose à Kildare avec une colère qui relève du traitement des cas médicaux, et non leur exactitude technique. La colère de Gillespie porte non pas sur les connaissances médicales du jeune interne, mais sur son comportement, et même : sur son état d’esprit. Dr Kildare utilise son premier épisode pour dire quelque chose que je ne suis pas certaine que beaucoup de gens aient pensé en 1961 sur leur médecin : « don’t get the idea that you’re a doctor just because someone starts calling you Doctor two minutes after you got that diploma in your hands and because you can write an RX. You go to school. You take training. You work here in the hospital. But you become a doctor with the help of your patient« .
Après cette saine colère, que Kildare ne prend pas vraiment très bien (en même temps il est perpétuellement courroucé par tout, ce jeune homme), la façon dont le héros comme la série abordent le cas de Julia Dressard évolue. D’hystérique et menteuse, elle devient complexe, et humaine, même quand elle est ramenée dans la Ward E pour avoir, cette fois, tenté de se suicider. Même quand elle réitère cette tentative sur son brancard. Kildare accepte de mettre son ambition et son orgueil de côté, et découvre qu’il peut aider… et même y trouver une forme de satisfaction. Et la meilleure façon d’aider est… d’écouter Julia. Pas sûre, une fois encore, que ce traitement de l’alcoolisme et du suicide aient pu aller de soi pour les spectateurs en 1961, mais Dr Kildare trouve le moyen, par son traitement, de discuter de choses essentielles. D’ailleurs, « fun » fact : dans les années 60, il existait encore 31 États dans lequel le suicide était illégal et donc passible de poursuite…
Pendant sa diffusion, Dr Kildare était l’une des séries les plus populaires de la télévision américaine. On ne saurait dresser un parallèle avec Grey’s Anatomy au risque de comparer les pommes et les oranges, parce que les circonstances de diffusion sont radicalement différentes… Force est de reconnaître, cependant, que les deux séries font quelque chose d’équivalent : s’adresser au grand public pour parler de questions de société sous un angle médical. Alors oui, le réalisme médical est important, et d’ailleurs les auteurs de Dr Kildare y mettaient un soin particulier d’après ce que je lis. Mais ce qui rend ces séries médicales si importantes, c’est bien leur traitement des cas médicaux.
…Cela signifie aussi que ce traitement est susceptible de sembler archaïque au bout d’un moment. Regarder ce premier épisode de Dr Kildare est parfois un peu rebutant ; la tournée est par exemple à la limite du choquant, vu comment les médecins considèrent aisément leurs patients comme des sangsues qui ne sont là que pour se payer des vacances aux frais de leur assurance médicale (il semblerait que l’assurance médicale ait été en plein boom à cette époque aux USA, ceci explique peut-être cela). Le traitement de l’alcoolisme de Julia Dressard apparaît aussi comme dépassé, quand bien même au final Kildare développe un embryon d’empathie pour elle en fin d’intrigue.
Ce qui fait l’intérêt de l’exercice détermine, en somme, ses limites : comme je le disais, c’est avant tout le reflet d’une époque. Ce qui apparaissait comme un idéal de médecine dans les années 60 (il se rapporte que des spectateurs écrivaient à la production pour obtenir l’avis du Dr Kildare !) n’en est plus un aujourd’hui.
Les séries participant aux discussions sur les sujets de société sont condamnées à une certaine obsolescence programmée.
Quelque part tant mieux. D’ailleurs j’envie les spectateurs qui regarderont Grey’s Anatomy dans 60 ans et se diront que, bon sang, on en a fait du chemin.





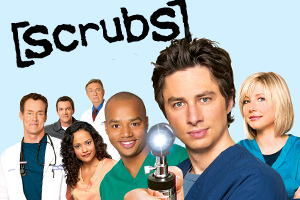






« j’ai aussi eu de grosses pensées pour Scrubs pendant cet épisode, d’ailleurs » … moi aussi pendant l’article, du coup. Bon, après, je pense quasi tout le temps à Scrubs dès qu’il est question d’hôpital (et parfois même quand il n’en est pas question), mais…
Et sinon, l’article m’a intéressée (comme d’hab, quoi), parce qu’au delà du sujet, la question de « que penseront les gens du futur de nos oeuvres actuelles ? » est une question que je me pose très souvent. Surtout pour les oeuvres qui nous semblent progressives. C’est difficile à imaginer… mais j’espère qu’ils aimeront Scrubs, quand même :’) (malgré ses défauts)