Mad Men s’achève ce soir à la télévision américaine, comme mille autres sources vous l’auront sûrement dit ces dernières semaines. La série se déroule, vous le savez forcément, dans le milieu de la publicité, et démarre au début des années 60 ; mais plus que de parler de publicité et uniquement d’elle, Mad Men ambitionne de parler de personnages complexes, et de la société américaine à travers eux. La pub n’est souvent qu’un prétexte pour ces explorations.
Ce n’est pas un tort, loin de là. Mais je me suis dit que pour faire nos adieux à la série en cette soirée de mai, rien ne valait la perspective de discuter du rapport des séries avec le monde de la publicité, et d’approfondir par la même occasion ce que Mad Men a parfois mentionné en passant.
Prêts à parler d’histoire télévisée américaine ? Eh bien d’accord, allons-y ! Mais je vous préviens : on ne va pas causer télévision tout de suite… et ça va donc être un peu long. Mais si vous n’étiez pas curieux, vous ne traineriez pas dans le coin !

Listen to the radio
Si vous vous êtes penchés ne serait-ce qu’une fois sur les soap operas, vous avez forcément entendu dire qu’ils doivent leur surnom aux marques de lessives qui les subventionnaient à leurs débuts. On le dit beaucoup moins, mais la pratique n’avait rien de limité aux soaps. Et pour mieux comprendre comment les marques s’inséraient dans la création de fictions, il faut remonter aux années 20 et à la radio.
A l’époque aussi, on trouve la publicité intrusive et irritante ; pour cette raison, elle est dans un premier temps interdite à la radio. Afin de contourner le problème, les émissions sont donc directement sponsorisées par des marques, et notamment les émissions musicales, qui comptent parmi les plus populaires du moment.
C’est par exemple le cas de The Clicquot Club Eskimos, une émission lancée en 1923 qui permet à un orchestre de banjo mené par le musicien Harry Reser d’obtenir un programme musical ; l’esquimau est en effet la mascotte de la marque Clicquot Club Company, qui vend de la ginger ale. Voilà qui explique assez bien le nom de l’émission. Le générique de celle-ci, interprété par l’orchestre au banjo, est en fait le jingle de la marque ! En outre, chaque émission démarre avec un annonceur décrivant les bienfaits de la ginger ale en plein hiver, puis qui explique comment reconnaître une bouteille de Clicquot Club avant de l’acheter (il y a un esquimau dessus !), et pour finir, raconte que pour se réchauffer, les esquimaux jouent du banjo. Vous avez vu un peu la transition ? Subtil. S’en suit une demi-heure de musique, entrecoupée de descriptions imagées sur la vie des esquimaux-musiciens-qui-boivent-de-la-ginger-ale, tout un programme. Dans The Clicquot Club Eskimos, on sait où a commencé la publicité, mais on ne sait plus trop où elle a fini ; si elle a jamais fini… On voit bien déjà comment la narration est inventée autour du principe commercial : le prétexte est de raconter de jolies histoires d’esquimaux, mais dans le fond, l’idée est quand même de présenter de la ginger ale sous toutes les coutures.
Les émissions musicales se prêtent bien à ce genre d’exercice, et rapidement, presque toutes sont sponsorisées, comme par exemple Kraft Music Hall, pour la compagnie Kraft Foods, qui est certainement l’une des plus célèbres et dont la diffusion démarre en 1933. Plus tard, à partir de 1941, l’émission King Biscuit Time poursuivra la tradition, mais avec des musiciens presque tous Afro-américains ; King Biscuit Time deviendra l’émission quotidienne la plus longue de l’histoire radiophonique américaine… et elle est encore sur les ondes à ce jour !
On reconnaît facilement ces émissions musicales sponsorisées : la plupart du temps, la compagnie obtient que son nom figure dans le titre de l’émission. Le procédé est vite étendu à d’autres émissions que musicales, dont les fictions. Pour les stations de radio, on n’envisage pas ça comme autre chose que de la publicité… et pour les compagnies et leurs agences publicitaires non plus. Pour tout le monde, sauf peut-être les auditeurs, l’objectif est simple : trouver un moyen de vendre une marque, et d’enluminer le résultat avec un peu de divertissement. La forme du programme devient rapidement dépendante de ce principe.
Du côté des stations elles-mêmes, on est bien trop content de ce nouveau système. On peut ainsi sans trop se fouler augmenter le nombre d’heures de contenu, et surtout, on peut augmenter les profits : à part les moyens techniques de diffusion, les radios n’ont rien à payer de leur poche. Tout se passe entre les marques en quête de publicité et leur agence publicitaire, qui a pour charge de trouver des idées, des auteurs, des interprètes, et tout ce qu’il faut pour faire une série.
Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit : dans les années 30, il n’existe pas de société de production à proprement parler. Non, toutes ces émissions radiophoniques sont entièrement produite par les publicitaires ! Les fameux ad men faisaient de la réclame, maintenant ils font de la série : aucune différence pour eux. De la même façon que Kraft Music Hall, créée pour la marque Kraft, est entièrement produite par l’agence J. Walter Thompson, des séries comme l’anthologie Lux Radio Theatre émanent intégralement des bureaux de ses publicitaires. Ceux-ci ne sont par contre mentionnés à aucun moment pendant les programmes ; de ce fait, les auditeurs n’ont aucune idée de la nature de ce qu’ils écoutent.
Carte blanche sur la forme
C’est que, vous voyez, aux débuts de la radio américaine à la fin du 19e siècle, on aimait encore produire des émissions de fiction où l’on déclamait du Shakespeare, ou bien où l’on proposait à des troupes théâtrales de produire leurs propres histoires au format audio. Eh bien ça, c’est bien fini, ou quasiment : après les premiers essais concluants des années 20, décrits plus haut, il apparaît clairement aux annonceurs américains que la fiction n’est qu’une publicité comme une autre (la radio britannique et notamment la BBC, au passage, s’accrochent encore plusieurs décennies aux programmes culturels, mission de service public oblige). Les stations américaines, quant à elles, se déchargent totalement sur les ad men en ce qui concerne toute « ligne » éditoriale, et ne supervisent pas les contenus, se bornant à vendre une plage horaire. Peu leur importe ce qui se dit ou se fait pendant le temps imparti, dans les limites de la loi évidemment. Et comme la loi se contrefiche du sponsoring, ça ne demande pas trop d’efforts.
Tout cela permet une certaine liberté de genre : comédies, thrillers, aventures ou autres, se multiplient sans que les radios n’aient envie d’avoir leur mot à dire. Les ad men laissent faire leur imagination, du moment que le contexte choisi met en valeur les produits dont ils ont la charge.
De plus en plus de séries vont donc être sponsorisées par des marques, même si, à la différence des émissions de divertissement ou musicales, leur nom n’apparaît pas nécessairement dans le titre de la série radiophonique. Il n’y a plus vraiment besoin de se donner cette peine : les restrictions légales sont progressivement levées jusqu’à la première moitié des années 30, et la publicité n’est alors plus soumise aux mêmes contraintes que jadis. Et puisqu’il est possible de proposer de véritables « pages » de publicité à la radio, paradoxalement, les marques sont moins présentes… pendant les programmes qu’elles subventionnent pourtant elles-mêmes à des fins publicitaires ! Les séries radiophoniques sont généralement préfacées d’une annonce (« …vous est proposé par… »), répétée au début du programme et à la fin, mais le contenu diminue nettement ses références explicites à un produit et/ou une marque.
Les premiers soaps radiophoniques naissent à cette époque, et doivent donc leur surnom, on l’a dit plus haut, au sponsoring pratiqué par des compagnies comme Procter & Gamble. Cette société de produits d’entretien et de beauté est l’une des premières à se lancer dans l’aventure, avec une série sponsorisée par son savon Oxydol. Très vite, Colgate-Palmolive et Lever Brothers, concurrents sur le même secteur, se lancent également à l’assaut de la radio quotidienne.
Pourquoi quotidienne ? Parce que vient d’être identifiée la cible de la fameuse « ménagère », celle qui fait les courses, décide des achats de biens courants… mais aussi, est à la maison, près de sa radio, toute la journée. Les ad men se sont trouvé une victime qu’ils ne lâcheront plus jamais. C’est là la raison essentielle de la dénomination « soap opera » : il s’agissait uniquement de lancer des séries radiophoniques ayant cette cible publicitaire, et donc d’offrir aux maîtresses de maison un produit sur-mesure… pour acheter un produit bien ciblé. Mais vous l’aurez compris, la seule différence notable entre les soap operas radiophoniques et les autres séries, c’était ce qui était vendu, pas le sponsoring dans son ensemble…
 « Excuse me Madam, do you have a moment to talk about our savior Procter & Gamble ?«
« Excuse me Madam, do you have a moment to talk about our savior Procter & Gamble ?«
Cette première série quotidienne que Procter & Gamble sponsorise, c’est Painted Dreams, créée par une certaine Irna Phillips en 1930. Mais bien-sûr, Irna Phillips, vous vous en souvenez forcément : on a parlé de son apport au genre sériel dans un portrait de créatrices de séries ! Après avoir quitté sa profession d’enseignante, elle commence à travailler dans la writers’ room de talk shows radiophoniques, avant de vouloir s’essayer à l’écriture de fictions (je dis écriture pour aller vite, vous savez pourquoi si vous avez lu son portrait). La série Painted Dreams, créée pour la station de radio WGN basée à Chicago, raconte la relation entre une mère et sa fille célibataire, largement inspirée de la relation de la scénariste avec sa propre mère. Phillips accepte un peu à contre-cœur l’investissement de Procter & Gamble, et change ses intrigues pour marier sa jeune héroïne ; avec ces tribulations de jeune mariée dont le foyer est balbutiant, il est beaucoup plus aisé à Irna Phillips d’intégrer des références aux produits de son mécène.
L’air de rien, Irna Phillips vient de créer ce que l’on considère aujourd’hui être le tout premier soap opera radiophonique, et on la verra reproduire plus tard l’expérience avec d’autres séries sur d’autres stations locales, puis nationales. Sa plus célèbre création radiophonique est évidemment le soap Guiding Light, qui deviendra l’une des séries télévisées les plus longues de l’Histoire. Je vous renvoie vraiment à son profil pour plus de détails quant à sa carrière.
Et puisqu’on cause, un petit aparté pour les téléphages cosmopolites.
Vous vous souvenez peut-être que, lorsqu’on a retracé la passionnante histoire du format, on a évoqué ces pratiques en passant. Dans les années 30, les publicitaires se disent qu’ils peuvent sûrement faire un peu plus d’argent encore en vendant leurs concepts d’émission à l’étranger. Après tout, puisque ce sont eux qui les produisent, ce ne sont que des concepts publicitaires, à vendre à un maximum de nouveaux clients. Or, en vendant leur concept de soap sponsorisés à des radios de pays comme le Brésil, le Mexique ou Cuba, les prédécesseurs de Don Draper donnent sans le savoir naissance à la radionovela… elle-même ancêtre de la telenovela. Il ne sera pas dit que les publicitaires n’ont rien apporté à la télévision mondiale !
Bref, tout l’univers radiophonique va adopter le sponsoring comme mot d’ordre, de près comme de loin, si bien que pendant la seconde partie des années 30, quasiment tous les programmes, qu’ils soient de fiction ou non, sont créés sur ce modèle : une compagnie veut de la promotion, donc une agence de publicité lui produit une émission, et au final, une radio la diffuse sans sourciller. Confort total.
S’adapter à un nouveau medium
En 1941, la phase préliminaire de la télévision américaine est derrière elle : les essais techniques se sont multipliés avec les années, et en dépit du nombre de postes encore réduit dans les foyers américains, le medium semble prêt à passer à la vitesse supérieure. Le 1er juillet précisément, la FCC (soit la Federal Communications Commission) ouvre deux fréquences non-expérimentales, qui sont donc désormais exploitables à des fins commerciales… Hm, qu’entends-je, quelqu’un a dit « commercial » ? Bientôt, les publicitaires étendent au petit écran, encore balbutiant, leurs méthodes bien rodées par des années de pratique radiophonique. Aaaaah ! On va enfin parler de télévision !
A mesure que celle-ci va se développer aux USA pendant les années 40, les tentatives de publicité intégrée aux séries vont se multiplier. Cela se fait essentiellement par deux moyens.
D’abord, en décidant de ne pas se compliquer la vie : de nombreuses séries radiophoniques sont tout simplement transférées à la télévision. L’agence publicitaire J. Walter Thompson, dont on parlait plus haut, le fait pour des séries comme la comédie Ozzie & Harriet, par exemple, ou l’anthologie radiophonique Lux Radio Theatre, qui devient Lux Video Theatre pendant quelques saisons sur CBS puis NBC, dans les années 50. L’agence se contente transférer son savoir-faire publicitaire (ou scénaristique, on ne sait plus) sur le petit écran. Encore une fois, pour les créatifs de J. Walter Thompson, l’essentiel c’est de faire de la publicité, pour le reste il suffit de s’adapter au support.
Toutefois, beaucoup d’agences publicitaires sont réticentes à ces transpositions de leurs succès radiophoniques. Essayez de vous remettre dans le contexte : à l’époque, la télévision est nouvelle et pas très bien comprise. On sait que la radio s’insère bien dans le quotidien des gens, puisqu’on peut pratiquer toutes sortes d’activités en écoutant les programmes. Mais la télévision, il faut la regarder. Or, comment suffisamment capter l’attention du public pour faire de la publicité efficacement ? C’est compliqué et beaucoup ne savent pas trop s’ils veulent y risquer leurs contrats avec leurs clients. En outre, produire une publicité une fiction pour la télévision, c’est onéreux. En direct, une série radiophonique, si l’on exclut les acteurs et les scénaristes, peut être réalisée avec très peu de personnel : un preneur de son, un musicien pour les jingles et le générique (généralement à l’orgue), et un ou deux techniciens, maximum. Il y a toujours la possibilité d’enregistrer (la technologie s’est bien développée dans les années 40, et avec la démocratisation du phonogramme, ce n’est pas très cher non plus), mais de toute façon, c’est plutôt simple de ne pas se tromper avec le texte sous les yeux. Mais la télévision ? Pour l’instant, on ne sait faire que du live. Et du live avec plusieurs décors à changer, des cameras, des preneurs de son, des techniciens sur le plateau, le prix des costumes, le maquillage, sans parler de la nécessité de répéter des textes appris par cœur. Du coup, ça devient vite compliqué à gérer… et donc pas très rentable.
Pour finir, il y a aussi à l’époque toutes sortes d’inquiétudes sur l’état de la société américaine si celle-ci venait à être détournée de ses activités par des fictions télévisées (une angoisse aussi vieille que la télévision, donc).
 Kraft Television Theatre annonce la couleur… enfin, façon de parler.
Kraft Television Theatre annonce la couleur… enfin, façon de parler.
Alors d’un autre côté, au lieu de reprendre des formats qui marchaient à la radio, on essaye de faire des fictions qui soient spécifiquement conçues pour la télévision. Je vous rassure tout de suite : l’aspect publicitaire est conservé, en utilisant le nom d’une marque dans le titre de la série.
C’est ainsi que le géant alimentaire Kraft aura, à partir de 1947, la série Kraft Television Theatre à son nom (plus clair, on ne fait pas). Pas besoin de se prendre la tête pour récupérer des personnages ou des scénarios qui fonctionnaient en audio : avec une anthologie comme celle-là, chaque semaine, des acteurs et des histoires différentes permettent de faire du contenu. Une grande partie des épisodes du Kraft Television Theatre sont au départ des adaptations d’œuvres classiques (en particulier si elles passent bien dans une émission calquant son mode de production sur le théâtre). Toutefois, grâce à des talents qui trouvent une opportunité de s’essayer à la télévision, on va trouver de plus en plus de projets inédits. Les publicitaires ont créé la série sponsorisée, maintenant les scénaristes et réalisateurs sont prêts à s’en emparer à des fins plus artistiques.
Au point que la série se détache un peu de sa vocation commerciale : Kraft revend les droits en 1958, et bien que rebaptisée Kraft Mystery Theatre, la série n’a plus rien à voir avec Kraft… la série est devenue une marque à part entière ! Enfin, bon, tout est relatif. L’acheteur ? Une agence de talents possédée par David Susskind, nommée Talents Associate, et qui a la particularité de gérer la carrière d’auteurs et de réalisateurs, plutôt que d’acteurs. La série permet, dans le fond, de mettre en avant des produits aussi, même si ces produits sont des créatifs et non du grilled cheese (l’agence J. Walter Thompson les a inventés pour Kraft en 1930 dans des campagnes radio). En tous cas, cela permet à l’anthologie de délaisser de plus en plus les adaptations ; plus tard, en 1963, elle est rebaptisée Kraft Suspense Theatre et ne propose alors plus que des histoires inédites.
En fait, la présence d’un nom de marque dans le titre d’une série devient rapidement un outil pour distinguer les séries anthologiques les unes des autres. Puisque rien ne lie les épisodes entre eux (pas d’acteur récurrent, souvent pas même de présentateur, et une grande variété d’intrigues), la seule façon pour une série anthologique d’avoir une identité reconnaissable qui incite les gens à revenir, c’est son nom. Et si son nom est celui d’une marque déjà largement entrée dans les foyers américains, eh bien, on ne va pas se mentir : la tâche n’en est que plus aisée.
C’est ce qui explique le nombre de séries anthologiques (et il y en aura une bonne quinzaine à l’époque) avec un nom comme Armstrong Circle Theatre (également achetée par Talents Associate), Goodyear TV Playhouse, The Philco Television Playhouse, Ford Theater, The United States Steel Hour, Kaiser Aluminum Hour, ou encore DuPont Show of the Month. Saurez-vous deviner les marques qui se cachent astucieusement derrière le titre de ces programmes ?
La même technique est également utilisée pour de nombreuses émissions de divertissement et de variété.
Pendant la décennie des années 50, la télévision devient LE support pour toucher le public. La radio tombe en disgrâce rapidement (beaucoup de séries radiophoniques vont être annulées pendant la décennie) et la publicité n’y est donc plus autant effective. Alors en parallèle, sur le petit écran, les dépenses publicitaires vont augmenter de… 75% ! Eh, on peut bien s’offrir quelques séries avec tout cet argent.
Hélas pour nos amis les publicitaires, c’est aussi dans les années 50 que les networks de la télé américaine commencent à se dire qu’ils veulent exercer du contrôle sur leurs programmes, et pas simplement laisser les ad men décider des contenus au nom de leurs clients, comme cela pouvait se passer à la radio. Les networks vont donc produire eux-mêmes de plus en plus de fictions, et donner plus de pouvoirs aux producteurs et aux auteurs, qu’aux agences publicitaires. A la même période, les networks créent des pages de pub, distinctes des programmes de leurs grilles, où sont reléguées les productions des agences : on ne mélange plus les torchons et les serviettes.
Tout cela oblige du coup les publicitaires à trouver un nouveau moyen de s’inviter sur les listes de courses des spectateurs. Pas de problème : on s’adapte encore une fois.
Le sponsoring n’est pas parti en fumée
A peu près toutes les séries de la fin des années 40 jusqu’au milieu des années 60 ont un sponsor, plus ou moins explicite. Dans les années 50, ce sponsoring est compliqué par les velléités de contrôle des networks. Soit : si on ne peut plus se contenter d’utiliser l’argent d’une marque pour répéter son nom toutes les 5 secondes, il faut simplement éviter l’évidence.
…C’est à cette époque que commence la belle et subliminale histoire du product placement à la télévision, dont il faudra hélas parler plus en détail dans un autre article (par chance, j’ai pu mentionner ce stratagème publicitaire dans des articles passés comme celui-ci pour la télévision sud-coréenne, ou celui-là pour la télévision US, et qui était mon tout premier article pour SeriesLive !). Quoi ? Bon d’accord, je suppose qu’on a le temps pour un petit paragraphe, mais ensuite on finit l’travail.
Les séries commencent par adopter une introduction plus discrète des produits à l’écran. Puisque les agences publicitaires ne peuvent plus produire de séries où marteler le nom de leurs clients, et que d’ailleurs lesdites agences ont gentillement été repoussées par les networks, elles vont essayer une nouvelle approche : subventionner des productions afin que des auteurs fassent le sale boulot eux-mêmes. La mission des ad men, s’ils décident de l’accepter, est d’acheter non pas des espaces publicitaires, mais des lignes de dialogues ou carrément des intrigues entières. On appelle ça de l’underwriting.
Le grand vainqueur de cette nouvelle façon de procéder, ce sera l’industrie du tabac.
Prenons un exemple concret pour détailler la procédure : la comédie Topper. Basée sur un film éponyme sorti en 1937, la série démarre sa diffusion en 1953 sur CBS, où elle met en scène Cosmo Topper, un riche banquier à qui tout réussit. Avec son épouse, Cosmo décide d’acquérir la somptueuse demeure laissée par un jeune couple qui vient de décéder dans une avalanche, ainsi qu’un Saint-Bernard du nom de Neil qui tentait de les secourir. Problème : le couple, George et Marion Kerby, tout comme le chien Neil, continuent de hanter les lieux. Seul Cosmo Topper est capable de les voir, ce qui conduit à plein de quiproquos, d’autant que le jeune couple tente d’épicer la vie très pépère du banquier.
La série Topper est sponsorisée par les cigarettes Camel, dont une publicité clôt systématiquement les épisodes. Ah, mais ce n’est pas tout : la marque exige que les Kerby soient montrés en train de fumer des Camel dans absolument chaque épisode (« vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein… il faut juste qu’ils fument »). Et si les producteurs veulent plus d’argent, tout ce qu’ils ont à faire, c’est employer les Kirby à faire passer des messages, répercutant par exemple la campagne de Camel qui envoie des paquets de cigarettes gratuitement dans les bases militaires et les hôpitaux pour vétérans (« vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein… il faut juste qu’ils lisent un communiqué de presse à un moment »).
Ça donne quelque chose comme les extraits suivants :
Topper est loin d’être la seule à pratiquer l’underwriting au nom des fabricants de tabac, et on peut relever de nombreuses occurrences dans The Beverly Hillbillies, The Dick Van Dyke Show (les cigarettes Kent ayant sponsorisé une demi-saison après le retrait de Procter & Gamble), ou encore, ce qui aura l’air de tomber sous le sens lorsque je l’aurai dit, le western Wanted Dead or Alive (Steve McQueen apparaîtra d’ailleurs dans plusieurs publicités, échange de bons procédés). Les westerns sont des proies faciles, entre autres à cause de leur budget plus élevé que celui des sitcoms ; ainsi, après avoir réussi à éviter le sponsoring pendant toute sa carrière radiophonique, la série télévisée Gunsmoke est sponsorisée par deux marques : les cigarettes L&M et les produits de rasage Remington. L’underwriting dans des séries historiques est toujours un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on trouve quand même à s’arranger.
Et au cas où vous essayeriez de penser à de vieilles séries qui marchaient bien et qui, oh non, ne mangeaient surtout pas de ce pain-là, ne vous fatiguez pas : même I Love Lucy, qui compte parmi les plus grands succès de la télévision des années 50, est sponsorisée par les cigarettes Philip Morris. Plusieurs gags tirent en effet partie des habitudes tabagiques de Lucy (apporter des clopes à son mari pour l’amadouer, se déguiser pour passer incognito mais se révéler en brûlant accidentellement le masque avec une cigarette, etc.), à défaut de forcément mentionner la marque à tous bouts de champs.
La pratique de l’underwriting va continuer jusque dans les années 60 pour les compagnies de tabac. Ah, par exemple, vous vous rappelez comme, dans La Famille Addams, Gomez fume de gros barreaux de chaise dans absolument chaque épisode ? Dutch Masters Cigars.
Tout était donc parfait dans le plus enfumé des mondes, jusqu’à ce que la législation commence à encadrer la promotion du tabac à l’écran (là encore, voir Mad Men). Les publicités pour le tabac disparaîtront définitivement des télévisions américaines au mois de janvier 1971 ; dans l’intervalle, les séries ont rarement refusé l’argent de Big Tobacco.
Je vois à vos mines déconfites que vous êtes sonnés par toutes ces révélations. Eh oui, sans le sponsoring de Philip Morris, il n’y aurait sans doute pas eu d’I Love Lucy ; ça laisse carrément songeur sur ce à quoi ressemblerait la télévision sans l’argent et les contraintes (…et les idées) des ad men.
Un avantage cependant : l’underwriting permet une chose : réduire les pages publicitaires. En termes de durée brute, les spectateurs sont gagnants. Considérez ceci : imaginons qu’un exécutif de network un peu nostalgique se pique de rediffuser là, ce soir, en primetime, un épisode d’une série des années 60. Eh bien, il faut l’amputer de 9 minutes pour pouvoir diffuser autant de pub qu’une série de 2015 ! Ou bien la diffuser en accéléré, mais personne ne serait aussi fou pour faire ça (oh, wait). Vous avez bien lu : à cause de la publicité, les séries ont perdu environ 9 minutes de contenu par semaine (et en plus leurs saisons sont moins longues aujourd’hui qu’alors).
Mais en échange, de nos jours, les sponsors n’interviennent pas, ou plus, ou disons, allez : moins, dans les scénarios. Pas convaincus ? Vous avez raison.
 « Imagine a TV that fills the room with drama », la publicité pour une télé LCD Samsung qui ne croit pas si bien dire.
« Imagine a TV that fills the room with drama », la publicité pour une télé LCD Samsung qui ne croit pas si bien dire.
Fast forward to…
Est-ce que de nos jours, c’est différent ? Hm… moui, mais… c’est-à-dire… en fait non. Car évidemment, aujourd’hui, des sociétés de production indépendantes ou affiliées à des networks fabriquent nos séries américaines, et plus les agences publicitaires. Et on ne trouve le nom d’aucune marque dans le titre d’une série à l’heure actuelle, même si parfois ça semble se jouer à peu de choses. Pourtant, les ad men n’ont pas totalement déserté le petit écran. Pire : le sponsoring comme l’underwriting sont toujours vivants, et ils se portent bien, merci de vous inquiéter.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé de les arrêter, pourtant. Devant la recrudescence de séries pratiquant l’underwriting, la FCC décide d’agir. A partir des années 70, elle durcit sévèrement le ton quant à la différence fiction/publicité. Sur l’underwriting, elle a du mal à imposer des règles, du fait-même du brouillage entre publicité et création, mais la Commission fait quand même de son mieux pour remettre les publicitaires à leur place : dans les pubs.
L’une de ses tentatives se matérialisera par l’encouragement de jingles ou annonces afin de signaler le début d’une page de publicité. Ainsi, beaucoup de séries de l’époque s’interrompent pour laisser la place à un annonceur qui prévient : « we’ll return after these messages » (« nous revenons après ces messages »), puis par « now back to our programming » (« et maintenant la suite de nos programmes ») lorsque la publicité est finie. Et toutes les variations possibles. L’idée est de rendre la transition aussi brutale que possible, pour bien signaler qu’il y a d’une part une démarche de divertissement, et d’autre part, une démarche commerciale. La FCC est en particulier inquiète pour les jeunes spectateurs, dont elle craint qu’ils ne réalisent pas trop la nuance entre les deux.
Toutefois, la FCC lâchera progressivement le combat vers le milieu des années 90, faute de réussir à vraiment juguler le problème. Car les publicitaires, vous savez ce que c’est : on les chasse par la porte, ils reviennent par la petite lucarne.
D’abord parce que le sponsoring de soap operas est très résistant. Là où les dramas, comédies et anthologies diverses se sont éloignées du principe, au moins un temps, les soaps y sont restés fidèles. Procter & Gamble est devenu le sponsor du soap télé As the World Turns en 1956 lorsque la série a été créée par Irna Phillips (la série était conçue dans le même univers que Guiding Light). Eh bien ce partenariat va perdurer jusqu’à l’annulation d’As the World Turns par CBS en septembre 2010 ! Lorsque la série s’éteint, c’est le dernier sponsoring de Procter & Gamble à la télévision américaine qui disparaît, mais il aura résisté pendant 4 décennies et demies… On se sentirait presque nostalgique !
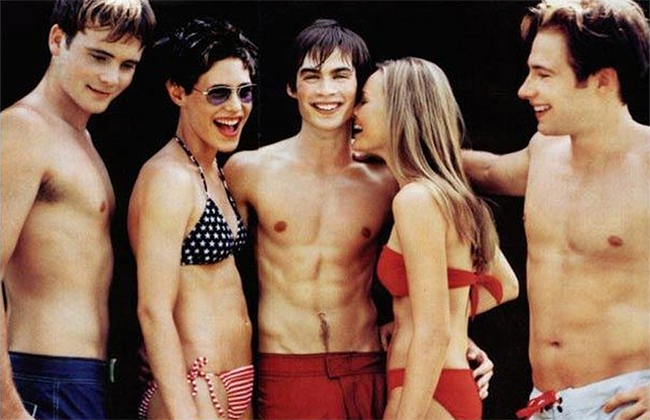 Young Americans a commis toutes sortes de crimes contre la téléphagie, on ne sait pas par lesquels commencer.
Young Americans a commis toutes sortes de crimes contre la téléphagie, on ne sait pas par lesquels commencer.
Bien que moins fréquent et surtout, moins explicite, le sponsoring existe toujours dans d’autres genres. Pendant l’été 2000, The WB décide de diffuser un spin-off à la série Dawson, centrée sur Will Krudski, un personnage récemment introduit en saison 3 : c’est le drama adolescent Young Americans. De là à penser que la série a été créée à des fins purement commerciales, il n’y a pas loin, et ça ne va pas s’arrêter là : Coca-Cola a investi 6 millions dans la production en tant que sponsor. Et comme à la belle époque de Topper, ça va aboutir entre autres à un product placement lourdingue. D’un autre côté, on était prévenus : « Coca-Cola summer premiere Young Americans » est la façon dont la série est promue en amont de sa diffusion, cette année-là, dans les bande-annonces et sur les posters.
Tous les épisodes de Young Americans mentionnent la boisson pétillante… au minimum. Évidemment c’est encore mieux si on peut la montrer à l’écran, ce qui se produit fréquemment aussi (la trépidante et lucrative histoire du product placement est loin d’être finie !). C’est à un tel point que la production a dû mettre à la poubelle son premier pilote, entre autres parce qu’il fallait tourner une nouvelle fois une scène… dans laquelle on voyait un distributeur de Pepsi en arrière-plan.
Heureusement, à ce moment-là, ce genre de pratiques passe moins facilement que dans les années 50, et Young Americans est fustigée par la critique et même par des humoristes (Steve Carell dans le Daily Show, par exemple) pour n’être qu’une vulgaire publicité d’une heure. Elle aurait aussi pu être fustigée pour ses intrigues incestueuses, ou le fait que quelqu’un avait décrété que Kate Bosworth pouvait tenir le rôle principal féminin d’une série, mais enfin, on ne peut pas être partout.
Fait amusant vu le contexte, le générique de Young Americans a été censuré par la production ! La chanson originale, intitulée Six Pacs, fait à l’origine mention de cigarettes en déclarant « Cigarettes and coffee wherever we go ». Craignant l’influence de ces paroles sur les jeunes spectateurs, la production fait réinterpréter la chanson avec des paroles plus conventionnelles, qui deviendront « Big dreams and wild schemes wherever we go ». Craignant l’influence sur les jeunes spectateurs. On croît rêver.
Et malgré la volée de bois vert que s’est reçue Young Americans, le sponsoring n’a pas disparu : il fait toutes sortes de retours en grâce à intervalles réguliers.
Quelques années plus tard, Trust Me joue en permanence sur le lien entre fiction et publicité ; ce n’est pas très surprenant : elle se déroule dans une agence fictive qui est en concurrence directe avec les agences publicitaires bien réelles Leo Burnett et DDB. Mais la série permet surtout à TNT de se lancer dans un partenariat fructueux avec nos vieux amis de chez Unilever (anciennement Lever Brothers), puisque la marque est le sponsor de la série.
Mieux encore : une intrigue de la série tourne autour d’une campagne que l’agence doit réaliser pour Dove… un produit Unilever ! L’accord incluait l’apparition en guest de Judy Pomerantz, chef de marque chez Unilever, ainsi que la mise en place d’un casual game dans lequel les fans de la série pouvaient s’imaginer être un décideur d’Unilever. Les intrigues de Trust Me mentionnent donc les produits Dove… mais aussi, plus rapidement Apple, Chris-Craft, Effen vodka, Green Giant, Hallmark, Kellogg’s, Nike, Pillsbury, Potbelly Sandwich Works et Starbucks (et ça c’est juste dans les deux premiers épisodes). Tout ça en mettant ces noms au même niveau qu’Arc Mobile, un opérateur mobile imaginé pour la série. Pas mal, pour une série dont le nom de projet était Truth in Advertising. Et quant on sait que la série a été créée par deux ex-publicitaires…
 « Hey mais je vous ai pas déjà vue quelque part, vous ? » / « Si, j’ai joué Bière n°2 dans The Americans. »
« Hey mais je vous ai pas déjà vue quelque part, vous ? » / « Si, j’ai joué Bière n°2 dans The Americans. »
Rescue Me, que FX lance pendant l’été 2004, va plus loin ; la série met en scène un pompier qui a bien du mal à se remettre de l’expérience du 11 septembre, et explore ses traumatismes ainsi que la façon dont son comportement erratique cause des dommages autour de lui. Alors bon, Rescue Me a recours au product placement de bières MillerCoors, ça, on ne peut pas y couper. Hélas, vous le savez, nous ne sommes pas ici pour parler de l’envoûtante et perverse histoire du product placement.
Beaucoup plus intéressant, Rescue Me est une démonstration qu’il est possible d’apporter la publicité sur le câble… sans pour autant imposer des coupures publicitaires. Retour en arrière ? Bah… vu ce qu’on a dit plus haut, on est en droit de se demander.
La première saison de la série n’a, a priori, pas recours à de l’underwriting, en revanche, le sponsoring est des plus évidents : la marque MillerCoors voit son logo apparaître à intervalles réguliers dans un bandeau pendant la diffusion de l’épisode. Des messages publicitaires tels que « vous allez regarder Rescue Me, avec MillerCoors » ou « merci d’avoir regardé Rescue Me, avec MillerCoors » s’affichent aussi en surimpression (on appelle ça des « overlay ads« ), à côté de la silhouette d’un des acteurs de la série, et ce en plein milieu des scènes dramatiques (un peu comme quand une série est promue pendant une autre, vous voyez le genre). Au moins, le spectateur n’est pas pris en traitre… c’est juste un peu dérangeant pour une série parlant d’un alcoolique.
Rescue Me n’a pas été créée par des publicitaires, je vous l’accorde, et elle semble plus se rapprocher de la fabuleuse et rentable histoire du product placement. Mais moi aussi, j’avance parfois masquée, et si je vous parle spécifiquement de MillerCoors, ce n’est pas par hasard.
Après tout, j’aurais aussi bien pu parler de la campagne équivalente de l’opérateur radio XM Satellite Radio Holdings pendant le season premiere de la saison 2 de Nip/Tuck, par exemple. Et d’ailleurs je ne vous parle pas non plus de FX par hasard, car MillerCoors a aussi fait affaire avec d’autres chaînes ; on peut par exemple mentionner du product placement dans Sullivan and Son sur TBS (où un coureur automobile sponsorisé par la marque est apparu dans son propre rôle), ou bien Franklin and Bash sur TNT.
Mais entre FX et MillerCoors, il apparaît que s’est tissée une véritable histoire d’amour au long cours ; vous allez voir que c’est une jolie romance.
La marque s’est invitée dans des épisodes d’It’s Always Sunny in Philadelphia et Sons of Anarchy, où ses bouteilles sont apparues, et on ne doute pas qu’elle y ait trouvé sa cible. Mais surtout, il y a tout juste un an, MillerCoors et FX ont finalement signé un deal : la compagnie est devenue le partenaire commercial exclusif de FX pour toutes les questions de bière pendant 3 ans. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais ça veut dire que désormais, dés que FX a une série en développement où pour une raison ou une autre, il est possible de montrer une bouteille d’alcool, la chaîne est légalement obligée de faire part à la brasserie MillerCoors des possibilités de product placement et de sponsoring avant tout le monde. MillerCoors a qui plus est son mot à dire sur la façon dont ses produits apparaissent à l’écran (leur simple présence ne suffisant pas !), ce qui est quand même diablement proche de l’underwriting. Les publicités de MillerCoors s’affichent, en outre, sur FXnow, l’application de replay de la chaîne.
Quant aux séries déjà existantes, elles n’ont pas été oubliées, et le contrat incluait l’apparition des bières Miller Lite et Miller High Life dans The Americans (avec habillage de style années 80 pour coller à l’identité de la série), la visibilité à l’écran de Coors Light et Blue Moon dans The Strain, et deux apparitions en guests des bouteilles Miller Lite et Leinenkugel dans Fargo. Et encore, ça c’est rien, le deal devrait également permettre à la brasserie de s’établir sur les séries de FXX aussi. A un moment, on est en droit de se demander dans quelle mesure tout cela influe sur la façon dont sont créées, commandées et produites nos séries, surtout quand ces accords sont signés avant que la moindre ligne de dialogue ne soit écrite.
En gros, les bières MillerCoors sont en train de se bâtir un CV plus important que 90% des acteurs de Los Angeles. Tout ça parce que la compagnie veut cibler un public (jeune et masculin) dont elle pense qu’il n’a pas la patience de regarder des publicités traditionnelles jusqu’au bout, ou pas du tout. Alors elle est allée le trouver dans les séries qu’il a tendance à regarder, sur le câble.
Le deal FX/MillerCoors fait envie à la concurrence : les fabricants de boissons alcoolisées sont en train d’accroître leur budget publicitaire ces dernières années. Et les pauvres, il faut les comprendre : à une époque où les gens zappent la pub ou ne la voient tout simplement pas, il faut bien ruser.
Dans le chaos ambiant, vous n’avez peut-être même pas remarqué que les séries créées uniquement à des fins publicitaires ont fait leur retour. On les croyait disparues en même temps que la popularité de la radio, et les ad men les ont fait revenir à la vie en douce !
La mini-série en 3 volets Falling For You est dans ce cas. Elle a été commandée par Target à son agence publicitaire, et on trouve au générique Kristen Bell, Nia Long et Zachary Abel. Derrière cette petite fiction sans grande ambition, la diffusion de Falling For You accompagnait surtout, en 2012, le lancement d’un magasin en ligne. Avec un avantage supplémentaire par rapport à une série traditionnelle, puisque lorsque les consommateurs voyaient dans la série un produit qui leur plaisait, ils n’avaient qu’à cliquer pour l’acheter. Le rêve éveillé de tout ad man.
Branded entertainment, qu’on appelle ça : le fait de créer du divertissement (souvent de la fiction mais parfois de la télé réalité, à l’instar de Fly Girls sur The CW, avec la compagnie Virgin America dans le premier rôle) pour enrichir l’image d’une marque. Et des exemples, j’en ai à la pelle… même si pour le moment, le phénomène est essentiellement circonscrit aux webséries.
Mot-clé : essentiellement. Parfois, la gangrène s’étend à la télévision traditionnelle. Vous vous rappelez de la comédie In the Motherhood ? Nan mais c’est pas grave, hein, ne vous mettez pas à chercher. Née en tant que websérie créée par l’agence publicitaire Mindshare pour les produits capillaires Suave, elle a pour vocation essentielle de s’adresser aux mères de famille, et de parler de leurs tracas quotidiens. Est-ce que par hasard ça ne vous rappelle rien ?
Après avoir trouvé le succès sur MSN (il faut dire Microsoft co-produit la série), elle finit par être commandée pour une saison entière sur ABC. Seule Chelsea Handler était présente au générique de la version sur internet et conserve son job, Leah Remini et Jenny McCarthy étant remplacées par Jessica St. Clair et Megan Mullally. Non, soyez raisonnables, je vous ai dit de pas chercher, même avec Megan Mullally au générique ça n’en vaut pas la peine.
Entre la façon dont In the Motherhood a été créée, et les exploits radiophoniques des publicitaires dans les années 20, la boucle est bouclée. Ne manque qu’un titre accrocheur. Pourquoi pas avec un nom de marque, tiens ?
Alors vous le voyez, la fiction télévisée doit tout, ou presque, aux publicitaires ; il n’était donc que justice qu’une série leur fasse honneur. Adieu Don Draper, et merci… Plus ou moins.









