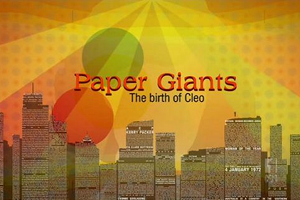Hey, les Australiens, je ne sais pas ce qui vous arrive en ce moment avec les period dramas, mais surtout : ne changez rien.
Je crois que ce qui me plaît le plus chez les Australiens, c’est que leur goût plus ou moins soudain pour les séries en costumes a tendance à porter sur des contextes n’ayant pas plus d’un siècle, et ça tombe bien, c’est comme ça que je préfère mes séries historiques : récentes. De Puberty Blues aux mini-séries Paper Giants, en passant par A Place to Call Home ou la récente INXS qui s’est conclue dimanche (je regarde le second volet et je vous dis ce que j’en pense), et j’en oublie, il y a vraiment de quoi être comblés.
Love Child, je vous en ai déjà parlé, ça fait plusieurs mois que sa diffusion était attendue sur le network Nine, à un moment où les chaînes australiennes commandent tellement de fictions qu’elles n’ont pas la place de toutes les diffuser en une année ! Finalement, Nine a fait débuter la série avant-hier soir, et à raison : la série a réuni 1,35 millions de spectateurs (dans un pays où toute audience de série en primetime au-delà du million est une bonne nouvelle), devançant même les inédits de Revenge sur Seven, qui a dû se contenter 862 000 spectateurs en comparaison. Pour vous donner une idée, hein.
Il faut dire que Love Child, outre son contexte surfant sur l’intérêt des Australiens pour les séries historiques, est produite par la même société qui a offert le succès House Husbands au le même network. Alors pourquoi arrêter une équipe qui gagne ?
Mais au-delà de l’opportunisme de la série dans le contexte actuel, ou de sa fabrication « certifiée conforme » aux audiences attendues par le network Nine, il y a chez Love Child de très intéressantes qualités, visibles dés le pilote. Et je m’apprête à partager ma découverte avec vous, petits veinards ! Allez, suivez-moi après l’image de promo.

A l’origine de Love Child, il y a une réalité commodément oubliée : la révolution sexuelle a moins de 50 ans, et les choses étaient alors bien différentes pour les femmes. D’un côté, elles n’avaient pas accès à une contraception librement choisie ; mais de l’autre, si elles tombaient enceintes hors des liens du mariage, elles devenaient alors des femmes impures ayant amené la honte sur leur famille entière. A cette époque, une grossesse hors-mariage se cachait, se conduisait dans le plus grand secret au sein d’établissements spécialisés tenus au secret, et ensuite… eh bien ensuite, pour que la jeune mère puisse reprendre une vie « normale », son bébé était adopté de force. Non, la mère n’avait pas son mot à dire.
Une situation qui n’a rien de spécifiquement australienne, mais qui était d’une ampleur suffisamment dramatique pour que, au printemps dernier, Julia Gillard, alors Premier ministre, offre de très officielles excuses nationales (une annonce d’ailleurs suivie quelques semaines plus tard par celle de la commande de Love Child…).
Love Child s’appuie donc sur ce passé pour douloureux pour raconter, à l’échelle humaine, ces drames. La série se déroule en 1969, auprès de l’hôpital Kings Cross de Sydney, auquel est accolée Stanton House, une institution hébergeant les jeunes mères, généralement mineures (et donc généralement parce que leurs parents les ont placées là) pendant leur grossesse, jusqu’à leur accouchement dans l’hôpital voisin.
Alors que le pilote démarre, ce sont deux personnages que nous allons suivre alors qu’elles arrivent dans cet environnement. Il y a d’une part la jeune Viv, qui après une nuit très excitante, se retrouve enceinte ; kidnappée par ses propres parents, droguée par son propre père pour que, inconsciente, elle soit plus facile à transporter, elle se retrouve, déboussolée, à Stanton House, sans la moindre explication. Elle y est accueillie par l’Intendante Frances Bolton, pas vraiment la personne la plus chaleureuse au monde, et qui en a vu d’autres ; elle dirige d’un main de fer Stanton House sans trop se préoccuper de rassurer ses jeunes pensionnaires, et de la materner bien moins encore (pardon pour le jeu de mots).
En parallèle, une nouvelle infirmière arrive à Kings Cross : Joan Miller, qui revient de Londres où elle a passé les dernières années, et où de toute évidence, tout ne s’est pas déroulé comme elle le souhaitait. Elle intègre la maternité de l’hôpital ; Bolton lui explique que bien que l’hôpital soit petit, c’est une aile de l’institution particulièrement occupée. Bah tu m’étonnes ! Entre les patientes « normales » et les pensionnaires de Stanton House, il y a du monde dans la salle d’attente !
Là où Viv est évidemment paniquée par la situation dans laquelle elle s’est trouvée en l’espace de quelques heures, qui plus est sans la moindre trace de sollicitude de la part de qui que ce soit, réagissant de façon bien compréhensible (voire prévisible) à ce qui lui arrive, Joan est au contraire un personnage qui bénéficie de suffisamment de temps pour être exposée et même développée, nous montrant une infirmière d’une grande bonté, très patiente et ne professant pas le moindre jugement, mais surtout, extrêmement talentueuse. Je ne vous en dis pas plus, faudrait pas que je vous raconte tous les détails non plus.
C’est donc à travers ces deux regards diamétralement opposés que le pilote va nous montrer la situation de ces jeunes femmes réunies à Stanton House contre leur gré. Les futures mères ne font pas l’objet de beaucoup de développement dramatique, car il ne s’agit pas (à l’exception de l’une d’entre elles, plus mystérieuse) d’explorer leur background ou même leur personnalité en profondeur.
Il est plutôt question d’aborder les multiples façons dont ces jeunes filles et jeunes femmes tentent d’exister à une période charnière pour les Droits des femmes, victimes d’une transition qui s’est amorcée mais qui rencontre une forte résistance.
Dés les premières images du pilote, Viv est cette jeune femme énergique et enthousiaste, souriante, désireuse d’explorer sa sexualité (elle feuillette compulsivement le Kama Sutra à l’arrière de la voiture où elle s’envoie en l’air avec un jeune homme), indiquant clairement que la révolution sexuelle des années 60 est largement en marche. Viv ne veut pas simplement avoir des relations sexuelles, elle veut clairement y prendre du plaisir, elle veut s’amuser. Malheureusement pour elle, ce plaisir est sanctionné par la société, et les conséquences sont non seulement une grossesse non-désirée, mais surtout une punition permanente. Outre le rejet par ses parents, son arrivée à Stanton House, régie comme une maison de redressement, est d’une grande violence. Les jeunes femmes sont méprisées par le personnel médical, et plus encore par l’Intendante ; elles sont enfermées sans possibilité de sortir de l’enceinte de Kings Cross, et en plus, elles sont forcées de travailler pour mériter leur place au sein de l’établissement… comme blanchisseuses pour l’hôpital ! Il y a quand même plus idéal pendant une grossesse.
Ce que Viv ne sait pas encore, et qu’une autre pensionnaire va nous apprendre pendant le dernier quart du pilote, c’est aussi le sort qui l’attend à l’issue de sa grossesse. Sans la compassion de l’infirmière Joan, l’accouchement se serait passé dans la douleur sans que cela ne dérange qui que ce soit, car l’honneur compte plus que le confort (pour réussir à convaincre le médecin de l’autoriser à retourner le bébé in utero, l’un des arguments finaux de Joan sera d’ailleurs : « on ne veut pas qu’une césarienne la défigure pour son futur mari et dévoile ce qui lui est arrivé »). Et surtout, le bébé est ôté sans ménagement à la mère qui n’a pas le temps de le voir, et moins encore de le tenir ne serait-ce qu’une fois. Là encore, Joan sera la seule à accepter de dire à la jeune mère le sexe de son bébé, ou la couleur de ses cheveux : on refuse à ces parias la moindre information, jusqu’au bout.
Lointaine cousine de Call the Midwife, la série Love Child promet, certes, des scènes d’accouchement, mais surtout de parler de la condition des femmes en des temps bien moins favorables, et pas si lointains. La reconstitution des années 60 est peut-être moins esthétique, moins recherchée que dans d’autres séries historiques australiennes (je pense à l’élégance des Paper Giants, par exemple), mais l’air du temps est là, et bien là, dans les vêtements, dans la musique, dans les références, mais, et c’est le plus important, dans les mentalités aussi.
Tous les personnages, on l’aura compris, ne sont pas égaux au regard du scénario. L’infirmière Joan Miller (Jessica Marais, déjà magnifique dans Magic City) irradie chaque scène, bien que son passé ne soit pourtant dévoilé qu’à demi-mots ; l’énergie fougueuse de Viv et son obstination à vivre alors que tout la contraint à la discrétion, voire à la repentance, reste par exemple assez superficielle, mais suffisamment prometteuse pour donner envie de voir comment elle va s’opposer au système qui veut à tout prix la réduire à un utérus résigné. Quant au Dr McNaughton, dont je n’ai encore pas parlé car son action est pour le moment secondaire, il est assez ambivalent, et la toute fin de l’épisode accentue le sentiment d’inconfort qu’il suscite.
Love Child n’est donc pas parfaite d’entrée de jeu, mais ce qui lui manque très ponctuellement sur la forme, elle l’a clairement sur le fond, quand il s’agit de discuter, les yeux dans les yeux, du sujet qui la préoccupe. A ma connaissance, c’est d’ailleurs la première fois qu’une série s’intéresse à ces maisons qui ont existé (et parfois existent encore) dans de nombreux pays, où les jeunes mères sont envoyées au vert quelques mois histoire de ne pas faire scandale. Le propos est donc suffisamment rare pour être applaudi, quand bien même il est traité, au terme de ce premier épisode (sur huit), avec quelques maladresses.
En ménageant une certaine légèreté, mais sans jamais oublier le but qu’il s’est fixé, le pilote de Love Child est plutôt courageux. Espérons que la série ne s’arrêtera pas en si bon chemin et offrira toute une saison à la hauteur.